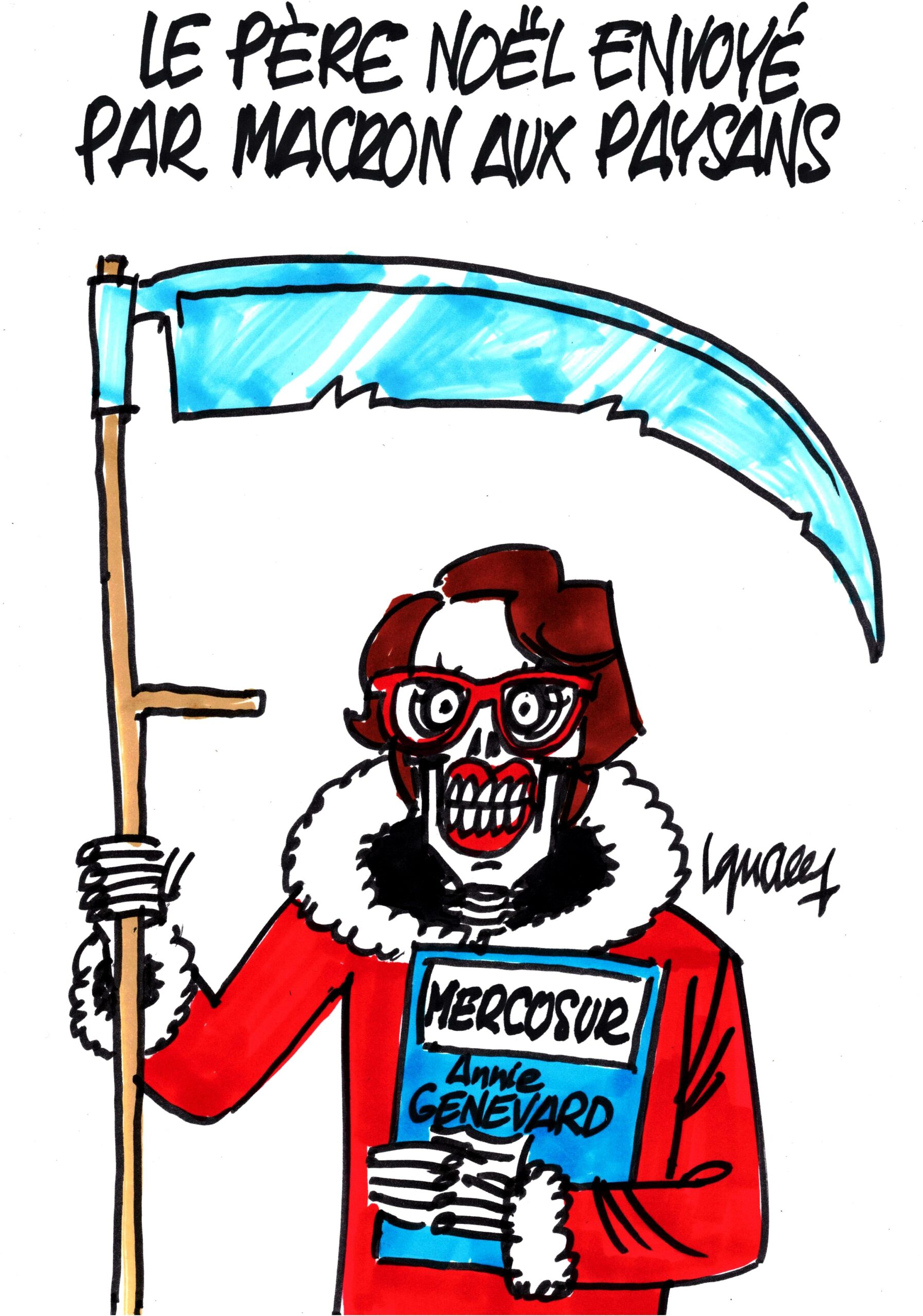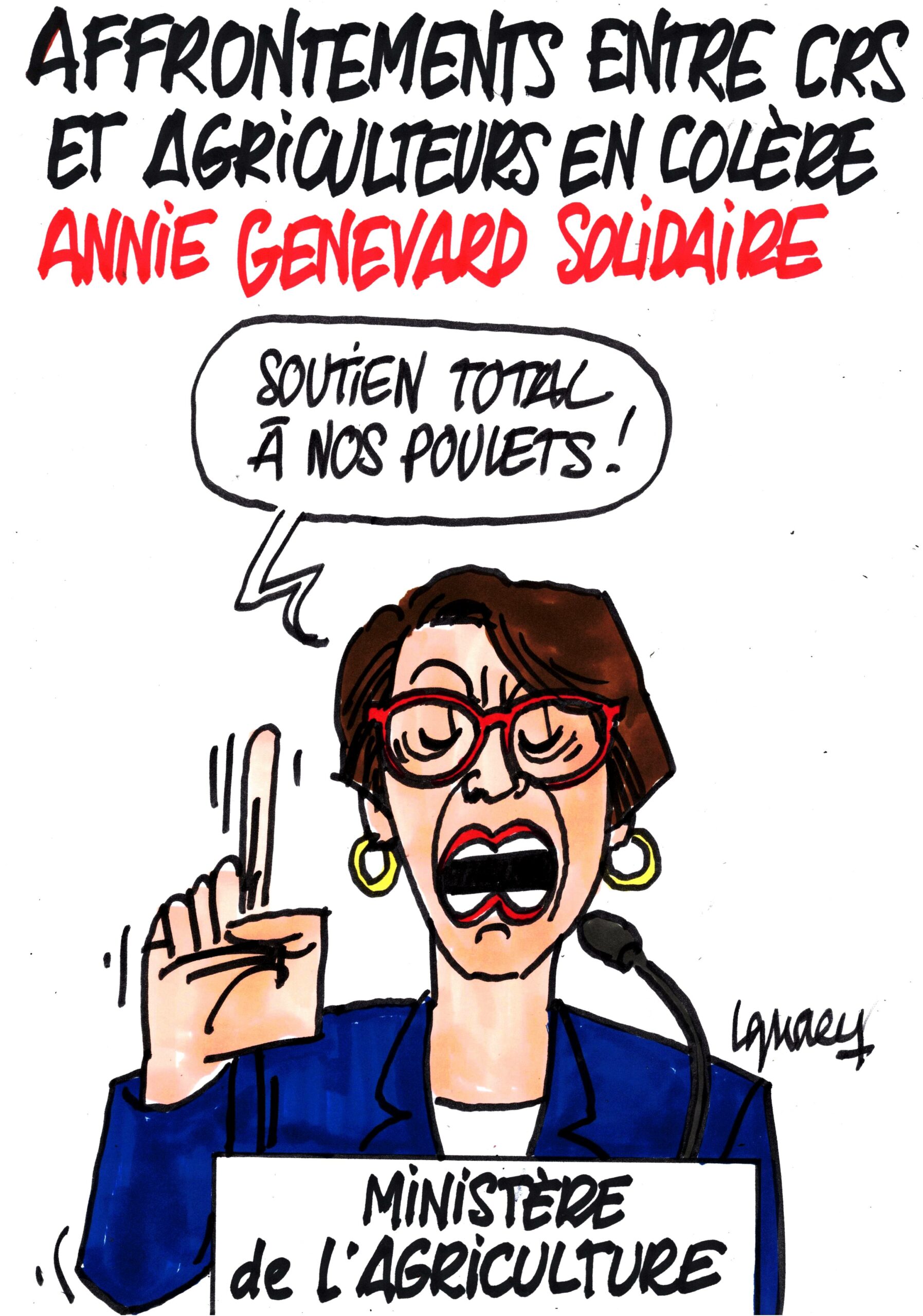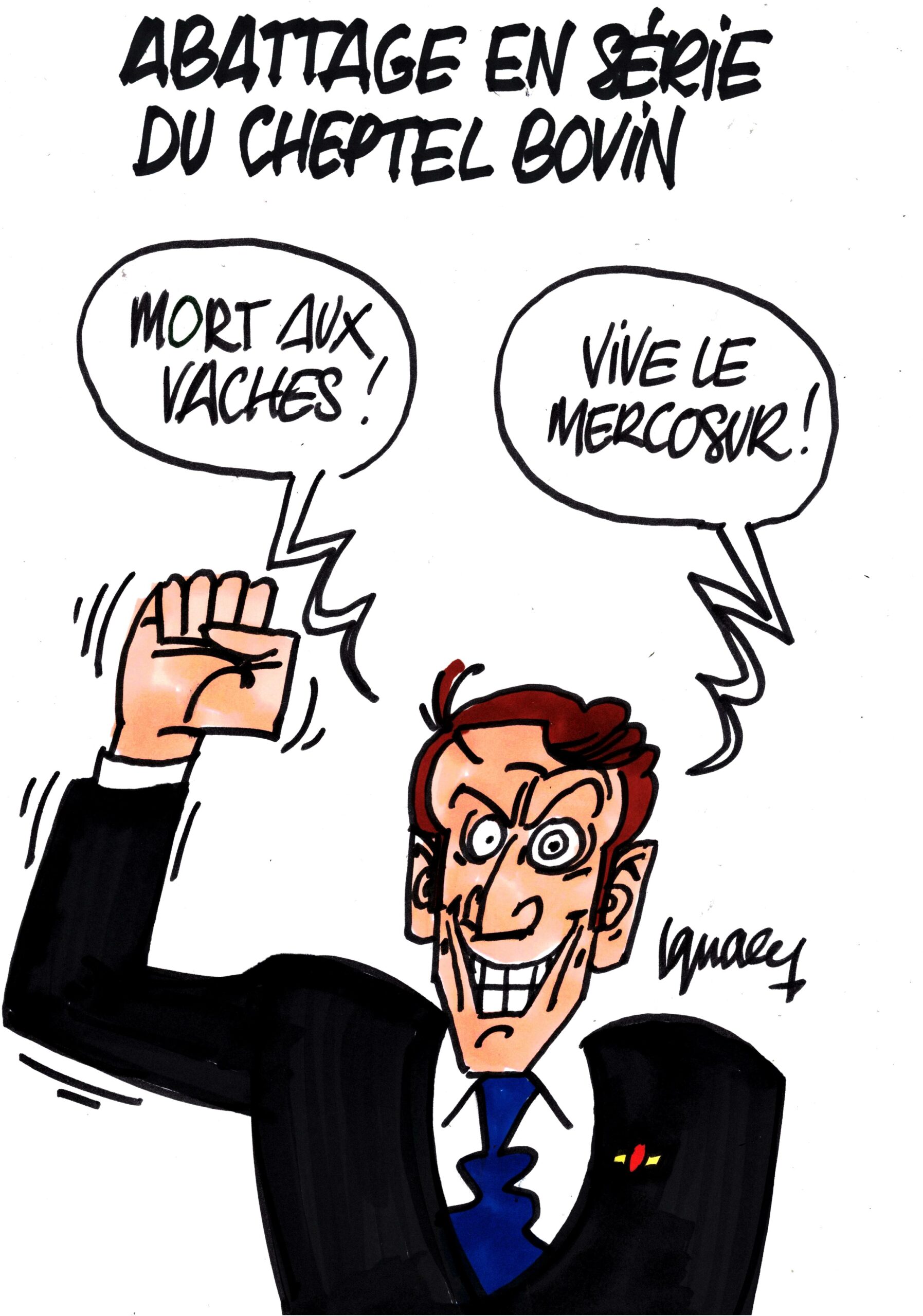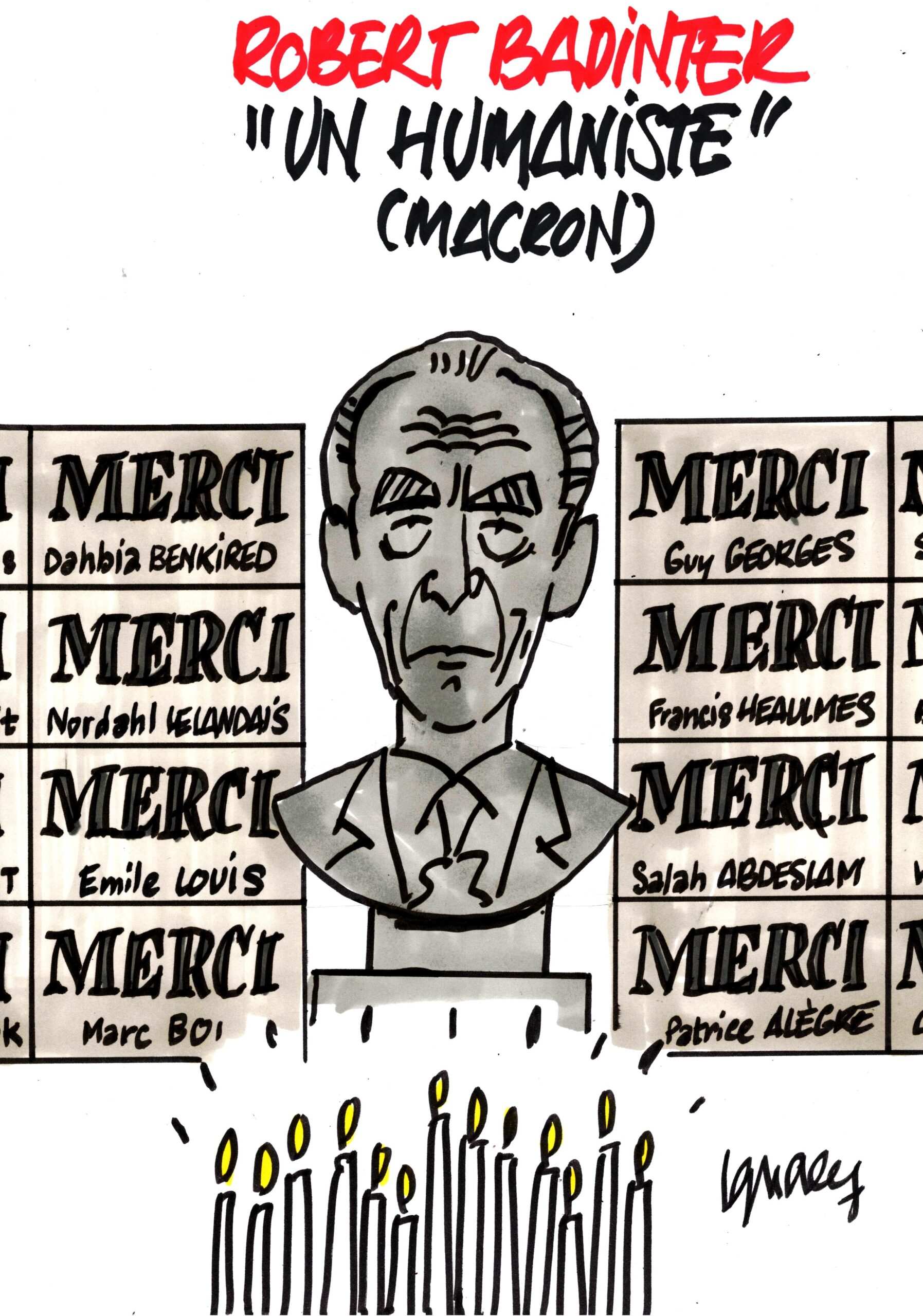« Dieu seul est grand, mes frères »
Si d’aventure certains de nos lecteurs veulent participer à cette plongée dans la belle culture française – et même étrangère – nous les invitons à se signaler à cette adresse contact@medias-presse-info.com et à nous envoyer leurs « notes de lectures » préférées aux fins de publication sur MPI.
MPI vous propose aujourd’hui un extrait du livre « Le roman du Roi-Soleil » de Philippe de Villiers (1).
Dans le dernier chapitre – intitulé « Il y a un art et de vivre royalement et un art royal de mourir » – nous assistons aux derniers instants bouleversants de Louis Le Grand.
La phrase suivante résume l’entièreté des magnifiques lignes que nous vous proposons :
« Pourquoi pleurez-vous ? M’avez-vous cru immortel ? Pour moi, je n’ai point cru l’être et vous auriez dû, à l’âge où je suis, vous préparez à me perdre. Regardez plutôt Celui qui demeure, le Roi des rois. »
Extraits tirés des pages 456 et suivantes :
« — Sire… Ce n’était pas une sciatique.
— Alors, qu’était-ce donc ?
— La gangrène…Françoise s’effondre. Elle quitte la chambre pour pleurer à chaudes larmes. Elle sait comme moi ce que signifie cette maladie. Il n’y a pas de guérison possible.
Le jour de la Saint-Louis, le 25 août, dès mon réveil, tambours et hautbois viennent sous ma fenêtre sonner une aubade selon la coutume. Je demande que les vingt-quatre violons jouent dans mon antichambre. D’une voix éteinte, je m’adresse à l’assistance :
_ J’ai vécu parmi les gens de ma cour. C’est parmi eux que je veux mourir. Ils ont suivi tout le cours de ma vie, il est juste qu’ils me voient partir. Messieurs, il ne serait pas juste que le plaisir que j’ai de prolonger les derniers moments que je passerai avec vous, vous empêche de dîner. Je vous dis adieu et vous prie d’aller manger.
La Saint-Louis me rappelle au souvenir de mon cher ancêtre : il a vécu ses derniers instants les bras en croix, allongé sur un lit de cendres comme un moine cistercien, configuré au Roi des rois. Il répétait sans cesse : « 0 Jérusalem… Ô Jérusalem… » II appelait la Jérusalem céleste… Un roi saint est un roi qu’on peut prier : il y a un art de vivre royalement. Il y a un art royal de mourir. Je supplie mon ancêtre, qui fut porté sur les autels, de me venir en aide, pour quitter cet ici-bas, comme lui, dans les élégances du port royal.
La noirceur, au-dessous de la jarretière, a gagné l’ensemble du pied. Le jour même, Madame de Maintenon me dispose à recevoir l’extrême-onction. Peu après huit heures du soir, s’introduisent par le degré dérobé, le cardinal de Rohan, grand aumônier, et Monsieur Huchon, curé de Versailles. Je sais qu’il n’y a plus de remède et que le répit de mon mal est de courte durée.
Au moment d’être ondoyé, je repense au jour de mon sacre, en 1654, il y a soixante et un ans : ce jour-là, dans la cathédrale de Reims, j’ai reçu l’onction du Saint
Chresme à l’intérieur de chacune de mes paumes. C’est pourquoi le cardinal de Rohan, revêtu de l’étole violette, choisit l’extérieur de mes mains pour m’oindre.Je fais appeler mes officiers, mes courtisans, qui se tiennent dans la galerie, portant perruque, habit serré et bas uni, pour leur confier un message d’adieu ; je veux laisser l’image d’une grande mort de chef d’Etat. Une mort auguste, aux sanglots retenus, une mort qui édifie, après une agonie maîtrisée. Bien sûr, j’ai la crainte de la grande traversée mais je ne veux laisser à personne
l’impression que je me noie.— Messieurs, leur dis-je, d’une voix éteinte, nous sommes à la fin. C’est l’heure des comptes. Je vous demande pardon du mauvais exemple que je vous ai donné. J’ai à vous remercier de la manière dont vous m’avez servi, et de l’attachement que vous m’avez toujours marqué. Je suis bien fâché de n’avoir point fait pour vous ce que j’aurais voulu faire. Les mauvais temps en sont la cause. Je vous demande pour mon petit-fils la même application et la même fidélité que vous avez eues pour moi. C’est un enfant qui pourra essuyer bien des traverses. Que votre exemple en soit un pour tous mes autres sujets. Suivez les ordres que mon neveu vous donnera. Il va gouverner le royaume ; j’espère qu’il le fera bien ; j’espère aussi que vous contribuerez tous à l’union et que, si quelqu’un s’en écartait, vous aideriez à le ramener. Je m’en vais, mais l’État demeurera toujours. Je lis dans votre regard votre émotion. Je sens que je m’attendris et que je vous attendris aussi… Je vous en
demande pardon. Messieurs, je compte que vous vous souviendrez quelquefois de moi…J’ai voulu mettre en garde tous ces princes contre le risque ou la tentation d’une nouvelle Fronde. Car je me souviens qu’à la mort de mon père, j’avais moi-même cinq ans, juste l’âge de mon arrière-petit-fils.
Je vois arriver les médecins de Paris. Leur toge noire donne du prix à leur latin de locution. Ils ont tous mis un œil de poudre à leur perruque. Ils se précipitent à mon chevet pour mieux alterquer. D’emblée, ils mettent fin au traitement au lait d’ânesse qu’ils jugent de trop peu d’effet. Le lendemain, j’entends l’apothicaire Anthome s’en prendre à eux en haussant les épaules :
— Ils ont accusé l’ânesse de ce malheur et l’ont dis- graciée sous prétexte que son lait n’avait pas plus de vertu que leurs raisonnements…En entendant cela, je suis atteint d’une grande mélancolie devant l’impuissance de la Faculté.
Alors j’appelle mon ami, le maréchal de Villeroy. Je lui confirme la désignation que j’ai faite :
— Monsieur le Maréchal, je veux vous renouveler mon amitié et ma confiance en mourant. Je vous ai fait gouverneur du Dauphin, c’est l’emploi le plus important que je puisse donner. Vous saurez, par ce qui est en mon testament, ce que vous devez faire à l’égard de Monsieur le duc de Maine. Je ne doute pas que vous ne me serviez, après la mort, avec la même constance que pendant ma vie. J’espère que mon neveu vous donnera des égards avec la considération et la confiance qu’il doit avoir pour un homme que j’ai toujours aimé. Adieu, Monsieur le Maréchal. En cet instant, croyez surtout à l’arme de la prière.
Le Maréchal pleure. Les médecins n’en ont cure. Ils s’approchent et pansent mon genou. Ils font de profondes incisions dans les chairs mortifiées du bas de ma jambe. J’entends qu’on s’agite au cabinet des Perruques et à l’Œil-de-Bœuf. Je vois venir à moi, qui sort du cabinet du Conseil, le duc d’Orléans, vêtu d’une soubreveste toute grise ; je lui accorde quelques mots :
— Mon neveu, vous voyez ici un roi dans le tombeau et un autre dans le berceau. J’espère que vous prendrez bien soin de ce jeune prince, votre neveu et votre roi. Je vous le recommande et meurs en repos, le laissant entre vos mains. Vous devinerez à travers mes dernières dispositions la confiance que j’ai en vous ; vous êtes régent du royaume, votre naissance vous donne ce droit et mon inclination est de concert avec la justice qui vous est due. Gouvernez bien l’État pendant la minorité de ce prince : s’il meurt, vous serez le maître ; et s’il vit, tâchez surtout d’en faire un roi chrétien. Qu’il aime son peuple et qu’il s’en fasse aimer. J’attends tout pour lui de vos soins. Je vous recommande aussi Madame de Maintenon. Vous savez la considération et l’estime que j’ai eues pour elle. Elle ne m’a donné que de bons conseils ; j’aurais bien fait de les suivre. Elle m’a été utile en tout, mais surtout pour mon salut. Faites tout ce qu’elle vous demandera pour
elle, pour ses parents, pour ses amis, pour ses alliés : je sais qu’elle n’en abusera pas. Qu’elle s’adresse directe-
ment à vous pour tout ce qu’elle voudra.Le régent me quitte après avoir déposé, au pied du balustre ses dernières affections et ultimes serments. On m’amène le Dauphin. Il sent le pain d’amande, il est encombré d’un pourpoint de velours avec un baudrier de maroquin trop lourd pour lui. Il se penche vers moi, le regard perdu et la bouche ouverte. Je l’embrasse et murmure à son oreille :
— Mon enfant, vous allez être un grand roi. Ecoutez un instant ces conseils : ne m’imitez pas dans le goût que j’ai eu pour les bâtiments, ni dans celui que j’ai eu pour la guerre ; tâchez, au contraire, de tenir la paix avec nos voisins. Rendez à Dieu ce que vous lui devez ; faites-le honorer par vos sujets, ce que je suis assez malheureux pour n’avoir pu faire. N’oubliez point la reconnaissance
que vous devez à Madame de Ventadour. Aimez la France et vos peuples plus que vous. Pensez toujours au baptistère de Reims : « Courbe-toi, fier Sicambre. » Courbe-toi, petit Louis de France… Et reste toujours en tenue de service…Le Dauphin est en larmes. Il ne dit mot mais il me laisse un billet sur lequel il a écrit quelques mots de tendresse : «J’aime fort mon cher papa roi. » À mon tour, je pleure.
Le 27 août, j’ordonne à Voysin un ordre particulier, qui touche à la symbolique royale. Je veux que le cœur du fils rejoigne celui du père.
— Aussitôt que je serai mort, vous expédierez un brevet pour faire porter mon cœur à la maison professe des Jésuites et l’y faire placer de la même manière que celui
du feu roi mon père.Alors, je fais signe à Madame de Maintenon ; elle s’approche lentement. Elle est habillée d’un damas feuille morte, coiffée en battant-l’œil et porte toujours sa grande croix de diamants. Je lui confie mes dernières affections :
— Chère Françoise, je vais partir. J’ai toujours ouïe dire qu’il était difficile de vivre l’épreuve du passage ; pour moi qui suis sur le point de ce moment si redoutable aux hommes, je ne trouve pas que cela soit si difficile. Et cela grâce à vous qui m’avez préparé à la Pâques. Adieu, Madame, je ne vous ai pas rendue heureuse ; mais tous les sentiments d’estime et d’amitié que vous méritez, je
les ai toujours eus pour vous.Quelques instants plus tard, on me dit que Françoise a quitté le palais pour retourner à Saint-Cyr où est sa nouvelle vie d’oblation. J’aperçois deux barbiers-barbants, portant la moustache à coquille et qui sanglotent. Je les console d’un mot attentif :
— Pourquoi pleurez-vous ? M’avez-vous cru immortel ? Pour moi, je n’ai point cru l’être et vous auriez dû, à l’âge où je suis, vous préparer à me perdre. Regardez plutôt celui qui demeure, le Roi des rois.
On m’a beaucoup dit, dans ma jeunesse, qu’il y a un art de retenir ses émois… Après avoir tant aimé les élégances de société, je veux pratiquer celles du grand départ, je veux finir à la pointe d’effacement où se rejoignent dans une perfection de ligne la grandeur et l’humilité absolue.
D’une voix de plus en plus faible, je reçois le curé lazariste Huchon, de la paroisse de Versailles ; il a le cheveu frondeur et le rabat mal ajusté.
— Monsieur le Curé, je vous supplie de vous souvenir de moi dans vos méditations et de faire prier pour le repos de mon âme quand Dieu aura disposé de moi
— Sire, tout espoir n’est pas perdu… Nous prions pour votre retour parmi nous.
— Non, non, Monsieur le Curé, lui dis-je d’un ton terme, ne demandez pas mon retour mais mon heureuse éternité.
C’est alors que je vois s’approcher, tapis dans l’ombre des bougeoirs, plusieurs cardinaux ainsi que le père Le Tellier :
— Messieurs, je suis bien aise de vous déclarer publiquement mes sentiments devant toutes les personnes ici présentes. Je veux vivre et mourir dans la religion catholique, apostolique et romaine que j’ai soutenue, autant qu il m a été possible pendant le cours de mon règne. Vous avez pu savoir que dans toutes les affaires qui ont regarde la religion et l’Eglise, je les ai protégées avec fermeté, mais. dans les dernières affaires qui sont survenues depuis, je n’ai suivi que vos avis et n’ai fait que ce que vous m’avez conseillé de faire. C’est pourquoi si j’ai pu mal faire, c’est sur vos consciences que vous en répondrez devant Dieu.
Je pense que le zèle avec lequel j’ai appliqué la bulle Unigenitus, au risque de susciter l’incompréhension d’une part du clergé, représente un legs difficile à assumer pour la succession. J’en ressens quelque remords.
Dès le 27 août, j’entre dans un assoupissement presque continuel. On me donne de l’eau avec un biberon. Je redeviens un enfant. Ô ma France, consacrée par mon père à la Sainte Vierge, la mère de Désolation et de Consolation au pied de la Croix. Notre-Dame de France. La domina, la maîtresse, la France est une dame, la France est une mère. La France est une mère de tendresse… Mes jambes ne répondent plus aux ordres des médecins. J’ai même quelques absences. La gangrène remonte depuis le mollet jusqu’à l’aine.
Le 31 août, la médecine s’en est allée. J’entends la voix des aumôniers, avec deux chœurs qui alternent pour les litanies, les versets et leurs répons.
— Des peines de l’Enfer, délivrez-le, Seigneur…
On récite les prières des agonisants. Je fais les répons, les yeux clos mais la voix forte. Il est tard. Je récite l’Ave Maria et le Credo. Puis je répète :
— Nunc et in hora mortis… Ô mon Dieu, venez à mon aide. Hâtez-vous de me secourir. Préservez-moi de la malemort.
J’entends la prière de saint Pierre Damien :
— Mon cher frère, je vous remets à celui qui vous a créé. Que la vaillante assemblée des anges vienne recevoir votre âme à sa sortie de votre corps. Que le sénat des apôtres, qui jugera le monde, vienne à votre rencontre. Que la blanche armée des martyrs vous accompagne en triomphe. Que le cortège resplendissant des confesseurs portant des lys vous entoure et vous conduise au paraclet.
Le 1er septembre, aux aurores, c’est le dernier soupir. Je serre mon petit crucifix entre mes mains jointes. On a déjà disposé autour du lit douze chandeliers. Je m’en vais, je m’efface. Je rends mon âme doucement, avec la tranquillité d’une chandelle qui s’éteint. J’entends à peine, j’entends de loin :
~ Subvenite, sancti Dei, occurite, angeli Domini. Venez à son secours, saints de Dieu, courez à sa rencontre, anges du Seigneur, recevez son âme, et veuillez la présenter au Très-Haut.
Je récite, par devers moi, la prière de Saint Louis :
— Adieu ma France… Beau Sire, Dieu, aie merci de ce peuple… Que jamais il ne choie… Je t’en supplie… Je commets mon esprit en ta garde… »
Louis le Quatorzième a été rappelé à Dieu le dimanche 1er septembre 1715.
Extrait de l’oraison funèbre prononcée par François Massillon :
« Dieu seul est grand, mes frères, et dans ces derniers moments surtout, où il préside à la mort des rois de la terre : plus leur gloire et leur puissance ont éclaté, plus, en s’évanouissant alors, elles rendent hommage à sa grandeur suprême : Dieu paraît tout ce qu’il est, et l’homme n’est plus rien de tout ce qu’il croyait être. «
Représentons-nous Massillon dans la chaire, prêt à faire l’oraison funèbre de Louis XIV, jetant d’abord les yeux autour de lui, les fixant quelque temps sur cette pompe lugubre et imposante qui suit les rois jusque dans ces asiles de mort, où il n’y a que des cercueils et des cendres, les baissant ensuite un moment avec l’air de la méditation, puis les relevant vers le ciel, et prononçant ces mots d’une voix ferme et grave : Dieu seul est grand, mes frères ! Quel exorde renfermé dans une seule parole accompagnée de cette action ! Comme elle devient sublime par le spectacle qui entoure l’orateur ! Comme ce seul mot anéantit tout ce qui n’est pas Dieu ! (Jean-François de La Harpe in « Le siècle de Louis XIV« .)
Joseph de Kent
(1) « Le roman du Roi-Soleil« , Editions Plon
Autres « Notes de lecture » de MPI
– « Inexplicable Vendée » – « Un jour je rendrai les honneurs au chardonneret perdu ».
– Francis Jammes : « Mon Dieu, faites qu’avec ces ânes je Vous vienne »
– Avortement : « c’est un viol des convictions intimes. C’est la fin du serment d’Hippocrate qui date du IVe siècle avant Jésus-Christ »
– Céline !… simple petite fleur Céline, n’envie pas les fleurs de jardins.
– Le grand mensonge de la création de l’union européenne : « une vérité officielle », portée comme une Arche d’alliance par les lévites de Bruxelles ?
– Retirés du monde pour psalmodier l’aube à venir
– Les parents du célébrant après la première messe : une profonde émotion
– Un petit tour par la ruche : une écologie sous le regard du Créateur.
Cet article vous a plu ? MPI est une association à but non lucratif qui offre un service de réinformation gratuit et qui ne subsiste que par la générosité de ses lecteurs. Merci de votre soutien !