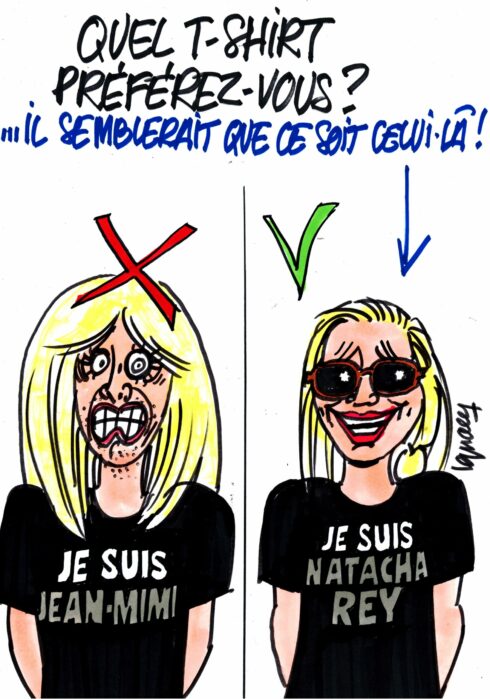Introduction
Est-il important de définir ce qu’est « une science » ? Pour l’épistémologue T. S. Kuhn vouloir définir la science (ou une science) masquerait des préoccupations non scientifiques. Il donne l’exemple de la psychologie dont la définition comme science importerait moins que les progrès réalisés dans la connaissance du fonctionnement du psychisme. Pour Kuhn, une science serait « tout domaine ou le progrès est net » !
K. Popper de son côté croyait pouvoir mettre une séparation entre la métaphysique et la science, définissant la première par opposition à la seconde au moyen du critère de la réfutation (la métaphysique, comme les dogmes, ne serait pas scientifique car non réfutable par des procédés rationnels).
Suivi en cela par la grande majorité des scientifiques et des savants des sciences humaines ceux-ci ne craignent pas d’admettre ou d’affirmer, à l’instar de H. Reeves – lors d’une conférence sur les arguments en faveur de la théorie du Big Bang, et se référant à Popper -, que la science n’a pas de rapport avec la vérité, (sous-entendue : la vérité relève de la sagesse, des convictions, de la philosophie, des croyances…).
Ces points de vue, et bien d’autres définitions, qui ramènent l’idée de science à la capacité prédictive ou à la méthode employée (expérimentation, mathématisation, par exemple), sont si contraires à la définition classique de la science, dominée par le réalisme philosophique, qu’il vaut la peine de rappeler en quoi consistait et consiste toujours cette définition, écartée pour des raisons elles-mêmes plus idéologiques que critériologiques, c’est-à-dire réellement scientifiques.
Toutefois, avant d’exposer les critères qualifiant « la science », soulignons encore que la question au singulier (« qu’est-ce qu’une science » ?) pourrait, paradoxalement, insinuer un pluriel, comme s’il n’y avait de « science », que parce qu’il y a des sciences, sciences tournées vers des réalisations pratiques ou techniques, suivant en cela les épistémologues et les points de vue cités, et ceci à l’encontre de l’adage ancien remontant à Aristote (384-322) d’après lequel « il n’y a de science que du général » (Non datura scientia de individuo).
Contre cette interprétation utilitaire et techniciste, faussement modeste à vrai dire – elle a créé l’illusion sociale d’une science toute-puissante et vérifié en un sens le mot de Nietzsche : « le prix du progrès c’est la mort de l’esprit » -, nous voulons opposer la définition et la caractérisation traditionnelle, la seule qui permette de déterminer dans quelle mesure tel champ du savoir peut recevoir ce titre de science, autorisant à dire, par exemple : la physique est une science, la philosophie n’en est pas une, la ou les science(s) économique(s)…, etc.
Si l’on se rapporte d’abord à l’étymologie, celle-ci nous indique que le mot science signifie simplement « savoir ».
En consultant les manuels de philosophie réaliste nous apprenons que la science est une manière particulière de savoir caractérisée par trois critères : 1° la certitude, 2° la connaissance des causes, 3° l’application d’une méthode.
Présentons ces trois notes distinctives, applicables à toute science en tant qu’activité objectivable ou à la science comme qualité d’un sujet intellectuel, avant de montrer que ces critères procèdent et reconduisent à la notion de vérité.
1° Une connaissance certaine
En tant que savoir, la science partage le caractère de la certitude avec la connaissance vulgaire (au sens de connaissance « commune »). Je sais que tout objet abandonné à lui-même tombe (pesanteur), c’est une connaissance ordinaire certaine, pourtant ce n’est pas comme telle une connaissance scientifique. Pour le devenir, cette connaissance devra rendre compte du fait général de la chute des corps exprimé par une loi, c’est à dire par un rapport constant entre deux phénomènes, entre une cause et un effet.
Autre exemple. Nous avons connaissance que telle plante coupe la fièvre, sans savoir ce qu’est la nature de la fièvre ou celle de cette plante. Posséder la science en ce domaine serait être capable de dire, non seulement que cette plante guérit, mais qu’elle guérira toutes les maladies semblables, parce qu’on en connaît le principe actif.
Toutefois, et en dépit de cette différence entre connaissance vulgaire et connaissance scientifique, il importe de noter que ces deux manières de connaître partagent ce double caractère de certitude (état du sujet) et d’évidence (qualité de l’objet) essentiels à tout savoir, certitude et évidence sans lesquelles notre esprit reste indéterminé ou dans le doute.
Penchons-nous un instant sur ces deux notions d’évidence et de certitude que partagent le sens commun et la science en général.
Prenons l’exemple d’une démonstration mathématique. Elle part de prémisses certains et aboutit à des conclusions tirées strictement de ces prémisses. Tout au long de la démonstration l’esprit vérifie l’exactitude des termes qu’il déduit à chacune des étapes du raisonnement se ramenant ainsi constamment à l’évidence de l’objet vu ou pensé et à la certitude qu’en a l’intellect à chaque moment.
Ce fait de l’évidence d’un objet donné à un sujet qui en a une conscience certaine est un fait indémontrable. Il permet de juger, il nous éclaire sans qu’on puisse l’éclairer autrement que par une autre évidence, tout comme la lumière du jour permet de voir et de distinguer la diversité des objets et ne peut être éclairée, si ce n’est par elle-même. Il serait vain de vouloir démontrer l’évident (par exemple l’existence du monde extérieur, le principe de causalité, voir plus bas) au moyen de propositions qui elles-mêmes recourent à cette même expérience première : « c’est une perfection plutôt qu’un défaut de ne pouvoir tout démontrer », écrivait B. Pascal.
Ainsi, faut-il affirmer avec Aristote, Thomas d’Aquin et les philosophes réalistes que « le critérium universel et dernier, marque infaillible de toute vérité et le motif ultime de toute certitude, n’est autre que l’évidence »5.
Toutefois, il est à noter que l’évidence et la certitude se manifestent à travers maintes expériences qu’il faut distinguer : certaines sont limitées au sujet qui les vit : par exemple « je sens, je souffre », elles sont particulières contingentes ; d’autres sont générales et objet d’une démonstration impliquant le fait premier (les trois angles d’un triangle sont égaux à deux droits) ; d’autres enfin sont universelles et employées dans toute science, tels sont les principes d’identité, de non contradiction, de raison suffisante avec ses corrélats : causalité, lois, finalité, cause première.
Vérités premières (métaphysiques) des sciences
I. Identité : toute chose est identique à elle-même, principe qui a quatre corollaires :
1) Non contradiction : sous le même rapport et dans le même temps, une même chose ne peut pas être et ne pas être ;
2) Tiers exclu : de deux propositions contradictoires, si l’une est vraie, l’autre est nécessairement fausse ;
3) Troisième équivalent : deux choses identiques à une troisième sont identiques entre elles.
4) Contenance : ce qui contient une chose contient aussi le contenu de cette chose.
II. Raison suffisante : tout a sa raison d’être ou tout ce qui est a ce qu’il lui faut pour être, soit dans son sens ontologique (origine de la chose), soit dans son sens logique. Appliqué à la réalité concrète, le principe donne immédiatement naissance aux principes de :
1) Causalité : tout ce qui est, et n’a pas de soi ce qu’il lui faut pour être, l’a reçu d’un autre qui est sa cause (moins universel que le principe de raison suffisante car la causalité n’est applicable qu’à ce qui reçoit l’existence, tandis que le principe de raison s’applique à tout être réel ou possible et à Dieu).
2) Lois : dans les mêmes circonstances, les mêmes causes (physiques) produisent toujours les mêmes effets (déterminisme de la nature) ; ce principe fonde le raisonnement inductif. 3) Substance : toute qualité, tout changement suppose quelque chose de durable, dont le phénomène est la manière d’être momentanée, i-e pas de modification sans objet modifié, pas de mouvement sans objet mû, pas de pensée sans être pensant.
Principes directeurs de la connaissance (découlent des précédents) :
– Cause première : toute cause seconde suppose une cause première pleinement suffisante qui tient d’elle-même sa raison d’exister.
– Finalité : tout est produit en vue d’un but (découle du principe de cause première, en ce sens que la fin est la raison qui détermine la cause intelligente à produire un effet, « la cause de la cause » dit Aristote).
– Moindre action : est une conséquence des principes de finalité et de raison suffisante : la nature suit toujours les voies les plus simples et les plus directes, agit toujours avec la plus grande économie de force et de matière ; elle produit le maximum d’effet avec le minimum de cause.
Cf. Ch. Lahr, Manuel de Philosophie, 2ième édition, Beauchesne, 1926, Deuxième partie, section II, chapitre premier – Les principes rationnels ou vérités premières, p. 139.
On avance parfois que les progrès des sciences au XXe siècle et certaines découvertes auraient ébranlé nos certitudes les plus élémentaires : les quantas de Planck (1900) et l’indéterminisme de Heisenberg (1905) auraient mis en cause l’idée que l’on puisse saisir objectivement un objet subatomique du fait de son ubiquité ou de son inexistence avant sa détection, relevant elle-même de la probabilité (fonction d’onde de Schrödinger) ; la relativité restreinte d’Einstein (1905) ferait douter de l’existence d’un temps universel irréversible ; l’incomplétude des systèmes logiques formulée par Gödel prouverait l’impossibilité de tout système d’axiomes à se prouver lui-même, ce que l’on prétend pouvoir étendre à tout système dogmatique.
Indiscutablement ces théories permettent de mieux déterminer les limites de nos connaissances : mettent-elles en cause les principes métaphysiques des sciences ? Aucunement, car ces théories et la démonstration de leurs théorèmes auraient été impossibles sans le recours aux vérités premières métaphysiques qui accompagnent les raisonnements et toutes les démonstrations bien construites : identité, non contradiction, causalité, déduction et induction. Du reste, mais ce n’est là qu’un argument d’autorité, les auteurs de ces découvertes logiques ou physiques n’ont cessé de faire référence à des constantes ou encore à l’idée d’objectivité et de réel ontologique : la vitesse de la lumière qui serait la vitesse maximale dans la théorie de la relativité ; le « mur de Planck » qui limite notre capacité à mesurer l’espace ou le temps ; l’indépendance des objets et lois mathématiques dans le réalisme platonicien de Gödel.
Second trait essentiel de la science, elle cherche à comprendre un fait, un événement, un phénomène, ce que nous pouvons résumer en disant qu’elle est une recherche des raisons ou des causes de ce fait, de cet événement, de ce phénomène.
2° Une connaissance par les causes
Que l’intelligence cherche à comprendre un fait est une façon de dire qu’elle en cherche la raison, terme qui renvoie, soit à l’idée de cause, soit à l’idée de finalité (le pour… quoi), soit encore à ce qui rend possible comme condition ou comme instrument le phénomène en question (soit les quatre causes – motrice, finale, matérielle et efficiente – d’Aristote).
On objectera que cette manière de voir est le fruit d’une conception naïve et d’une illusion car, après analyse, il n’y aurait rien qui ressemble à ce que l’on appelle une « cause » (pensons par exemple aux phénomènes climatiques qui ne semblent être que la réunion de multiples facteurs ou conditions sans cause exclusive déterminée). Telle est la critique des philosophes modernes qu’ont repris beaucoup de scientifiques, du moins lorsqu’ils sont questionnés sur leur épistémologie, car en pratique, ils recherchent tout bonnement le ou les facteurs causaux des objets qu’ils étudient.
Cette remise en cause de la notion de cause remonte aux sceptiques Grecs et dans les temps modernes à D. Hume (1711-1776), empiriste anglais pour qui la causalité est une illusion sans réalité objective, ne s’expliquant que par l’habitude d’associer des événements qui se produisent souvent ensemble.
Chez Kant (1724-1804) et chez les auteurs qui comme lui soutiennent que la science ne traite que des phénomènes représentables (dits « phénoménistes »), la cause est insaisissable par l’entendement, c’est une énergie, une force comparable à la volonté et à la liberté humaine, notions qui relèvent de la métaphysique et non de la science positive ; cette dernière se bornant à constater les antécédents et les conséquents de faits tangibles et mesurables.
Au XIXe siècle l’empiriste J. Stuart Mill (1806-1873) est allé jusqu’à soutenir que les axiomes de la géométrie – par exemple, deux droites ne peuvent se couper qu’en un seul point -, et même le principe d’identité (A est A), ne sont que des généralisations d’expériences particulières. Il n’y aurait donc ni causalité objective, ni principes réellement universels, la science serait toujours relative et provisoire.
*
Pour répondre à ces objections, il faut être attentif à deux aspects de la notion de causalité :
1) l’antériorité de la cause par rapport à l’effet considéré : en ce sens la cause est le phénomène nécessaire et suffisant déterminant l’apparition d’un autre phénomène (sens empirique et phénoménal).
2) la force exerçant l’action effective (« l’influx efficace » cf. Ch. Lahr) : c’est la raison ou cause réellement suffisante du phénomène (sens métaphysique).
Les positivistes et les phénoménistes ne veulent retenir que le premier aspect, le rapport antécédent-conséquent.
Or, s’il est vrai que, dans certains cas, la ou les causes d’un phénomène sont difficiles à isoler – soit en raison de la complexité du fait étudié, soit parce que la science du moment et ses instruments sont insuffisants -, il est en revanche erroné de penser que la causalité est une simple illusion (Hume et certains empiristes), ou même une réalité étrangère et insaisissable pour notre entendement (Kant et les positivistes).
En effet, nous avons une idée claire et objective de la causalité et nous pouvons pour ainsi dire démontrer qu’elle n’est ni illusion ni un noumène obscur derrière le phénomène.
En premier lieu, des concomitances répétées ne peuvent justifier de faire de la causalité une simple association mentale liée à une habitude.
Nous faisons l’expérience de phénomènes qui se répètent ensemble de manière quasi constante et cependant nous sommes loin de toujours conclure qu’ils ont un rapport de cause à effet. Pour le dire d’une boutade, le coq chante au matin depuis la nuit des temps, mais il n’est venu qu’à l’esprit des poètes de dire que le coq fait lever le soleil. Au contraire, d’autres phénomènes très capricieux et sans rapport visible ont pu être reliés par une même cause identifiable après recherche systématique et grâce à la connaissance de certains lois établies. Ainsi, en dépit de l’absence de lien évident, on a pu établir que les phases de la Lune sont la cause des marées sous l’effet de la loi de la gravité. Remarquons aussi que l’enfant dès son plus jeune âge, bien avant de contracter des habitudes d’esprit, répète inlassablement ses « pourquoi », alors que l’association répétée n’a pas encore eu un rôle important dans la formation de ses idées (notons au passage que ce besoin de comprendre tend à montrer que la raison possède un sens inné de la cause finale et du caractère transcendantal des concepts, témoignant par-là de la nature spirituelle et immatérielle de la raison).
En second lieu, et c’est le point essentiel, la cause ne se réduit pas à la relation d’antécédent à conséquent constants, elle implique aussi l’idée d’une force capable de produire la chose ou le fait, force dont nous avons l’expérience intime.
Bien que nous ne puissions appréhender de manière sensible le moteur qui produit l’action d’une chose sur une autre – qu’est-ce qui provoque la croissance des végétaux, le développement d’un embryon, le mouvement des êtres vivants ? –, nous avons néanmoins une expérience d’une force qui est aussi le moteur d’une causalité : c’est notre volonté d’agir et de penser ou de faire effort pour traduire en actes ou en paroles cette même volonté.
La cause en tant que qu’énergie ou moteur est sans nul doute un fait métaphysique, il ne nous est pas pour cela étranger comme nous le signale la conscience de nos actes. Dans cette expérience nous tenons en une même aperception, l’enchaînement objectif perceptible de la cause à son effet et la cause immatérielle, stable, substantielle et permanente qui le produit, notre volonté. Or, c’est cette même relation que nous expérimentons chez d’autres sujets actifs (hommes, animaux et même végétaux), mais aussi entre des phénomènes physiques qui sans posséder une cause volontaire immédiate procède d’une loi intelligible qui articule une identité objective bien définie à une autre.
Terminons en disant que s’il était vrai que la cause n’est qu’une spéculation indémontrable, il faudrait admettre qu’il y a des phénomènes sans cause(s) ou des faits soumis à des causes contradictoires – au sens strict de ce mot, par exemple soutenir simultanément que les marées s’expliquent et ne s’expliquent pas du tout par la gravité, que je suis l’auteur et pas l’auteur de mes actes etc.-. Dans ce cas, ce que l’on nommerait science ne serait qu’un amas d’associations accidentelles provisoirement reliées d’une valeur subjective, ce qui est peu ou prou la conclusion à laquelle conduisent les épistémologies de K. Popper (1902-1994) – en dépit de sa revendication de « réalisme » – ou de T. Kuhn (1922-1996) (la notion de « paradigme scientifique »).
Contrairement à ce que soutiennent les auteurs précédemment cités, la causalité n’est pas le produit d’une illusion liée à nos habitudes et à nos associations mentales, c’est un fait objectif d’évidence immédiate et première, à l’instar de l’évidence du monde extérieur et des premiers principes, et sur lequel on ne saurait abuser le sens commun9.
Bacon (1561-1626) qui a pourtant contribuer à restreindre la science à l’expérimentation physique – « Physique méfie-toi de la métaphysique »-, n’en déclarait pas moins que « la science véritable est la science par les causes » (Vere scire, per causas scire).
Affirmons donc que le second trait d’une science est d’être une connaissance par les causes : « Nous savons une chose d’une manière absolue, écrit Aristote, quand nous savons quelle est la cause qui la produit, et pourquoi cette chose ne saurait être autrement » (Second analytiques I, 2, 71, et I 33, 88).
Le caractère méthodique de la science est le troisième critère, caractère qui la distingue de la connaissance empirique et de la connaissance vulgaire (ordinaire).
3° Une connaissance méthodique
Qu’est-ce que la méthode ? « Au sens général du mot c’est l’ordre à mettre dans la série de ses différents actes pour atteindre une fin déterminée. »
En science, la méthode est « l’ensemble des procédés que doit employer l’esprit humain dans la recherche et la démonstration de la vérité. »
Précisons pour mieux faire apparaître la signification et la place de la méthode dans les sciences.
L’étude du fondement des sciences, de leur rapport à la vérité et du critérium de la vérité et de l’erreur est la logique critique ou critériologie, ou encore épistémologie. Nous en donnons ici un aperçu en rappelant les critères généraux de la science.
L’étude des conditions idéales – leur légitimité (droit), non les conditions de leur existence (fait) – du raisonnement est l’objet de la logique dite formelle : elle traite des règles de la pensée dans les raisonnements rigoureux, indépendamment de tout domaine concret : la déduction, le syllogisme et ses nombreuses modalités.
Puis, pour établir une vérité (loi, cause, fait réel), chaque domaine du savoir est contraint par l’objet même qu’il étudie, autant que par les règles de la logique, d’où le nom de logique spéciale ou appliquée, ou encore de méthodologie, réservée à l’étude des procédés qui s’imposent à l’esprit lorsqu’il étudie un champ particulier du savoir.
Rappelons certains des procédés caractéristiques situés aux principaux embranchements de l’arbre de la science.
Les mathématiques s’intéressent aux quantités et aux formes, abstraction faite de la nature des choses. Elles procèdent par définition (vérité générale résultant parfois d’une analyse), par axiomes (principes évidents indémontrables qui s’appliquent à toute espèce de grandeur), postulats (étymologiquement « je demande » que l’on m’accorde, ex. : postulat des parallèles d’Euclide), démonstrations déductives dont les procédés se ramènent essentiellement au syllogisme.
Les sciences physico-chimiques étudient des faits concrets et contingents dont elles recherchent la cause et la loi générale dans des circonstances accidentelles variables : chaleur, électricité, pesanteur… ; leurs variations quantitatives en ce qui concerne la physique ; les transformations moléculaires pour ce qui regarde la chimie.
Elles partent de l’expérience et s’élèvent du fait particulier à la loi générale, méthode dite inductive consistant à isoler le facteur causal par la variation des conditions de l’expérience (addition ou suppression, modulation de l’intensité des facteurs en jeu pour trouver la raison suffisante de l’effet). L’induction scientifique comporte quatre moments : l’observation, l’hypothèse (a priori ou tirée de l’expérience), la vérification par une expérience contrôlée ou expérimentation, l’induction proprement dite ou généralisation à tous les objets ou à tous les faits semblables, des propriétés reconnues à un certain nombre d’objets ou procédés.
Les sciences biologiques (zoologie, botanique, génétique,…) étudient l’anatomie des êtres vivants, leurs organes et leurs fonctionnements (physiologie) et les classent en espèces et variétés. Elles appliquent la méthode expérimentale dont nous venons de parler et emploient également l’analogie (que l’on retrouve dans toutes les sciences et dans les arts également), raisonnement consistant à conclure des ressemblances apparentes à d’autres non observées ou à une identité de fonctionnement (ex. la reconstitution d’un animal à partir d’un fossile sur le fondement de la loi de corrélation organique par Cuvier, justifiée par la découverte du Paléothérium quelques années plus tard).
Les sciences morales et sociales ont pour objet l’homme, être intelligent, libre et cause responsable de ses actes. Elles étudient les lois qui régissent les manifestations de cette activité morale (faits psychologiques et relations entre personnes), d’où les sciences psychologiques, historiques et sociales.
La subdivision des sciences morales peut également être faite en distinguant le point de vue positif (ou descriptif), qui constate les faits et essaie d’en déterminer les lois, et le point de vue normatif, dans lequel on s’efforce de découvrir ou de systématiser les règles que l’homme doit suivre pour atteindre ses finalités les plus hautes, conformes à sa nature d’être libre et doué de raison. Néanmoins, il importe de souligner que le caractère impératif de la norme, objet d’un choix libre, n’est pas purement conventionnel car celle-ci a un lien étroit avec les lois de la nature physique ou morale (inclinations profondes de la nature humaine). C’est faute de voir ce lien et certaines constantes que l’on a souvent refusé à ces disciplines le titre de sciences, en ne voyant dans leurs conclusions que des opinions. Les sciences morales sont pourtant à même d’identifier des causes et des lois nécessaires des comportements individuels ou collectifs, souvent avec une surprenante prévisibilité, signe qu’elles obéissent à des lois générales.
Les procédés des sciences de la nature s’appliquent aux sciences morales jusqu’à un certain degré et si l’on adapte certaines données factuelles. En psychologie, en histoire et en sociologie des faits tangibles peuvent faire l’objet d’expérimentation, d’induction et d’analogie, et l’on parvient à dégager les facteurs déterminants de certains phénomènes, bien qu’ils soient souvent plus nombreux et plus compliqués (ex. pénurie ou demande de certains produits et hausse de leurs prix, pour le cas le plus simple). En morale et en science politique, la déduction n’a rien d’exceptionnel car l’expérience et l’introspection aboutissent à une connaissance du corps et de l’esprit humain, et par là-même à la connaissance des relations humaines lesquelles permettent de dégager des lois de comportements des individus ou des corps sociaux.
Pour terminer ce tour d’horizon, insistons sur le fait que la philosophie et la théologie doivent aussi recevoir le titre de science.
La philosophie ne peut pas ne pas être une recherche d’identités et des causes, bien que son champ d’études soit le plus vaste qu’il soit, le réel tel qu’il s’offre à nous. A cet égard, comme l’écrit H. Collin, « Science et philosophie ne se distinguent pas tant par les choses qu’elles étudient (objet matériel) que par l’aspect sous lequel elles considèrent les choses (objet formel) » et par suite elle est « la science la plus élevée et la plus parfaite et l’on comprend sans peine qu’il ne peut y en avoir qu’une, comme il n’y a qu’une physique, qu’une chimie, etc.- de même qu’est unique l’ordre intime de l’ensemble des êtres qu’elle prétend exprimer. »
Certains objecteront peut-être que sa recherche n’aboutit à aucune certitude et que par là elle est subjective et vaine. C’est là une vue tout à fait erronée et partiale. La philosophie est en possession de vérités d’évidence certaines. Elle emploie les premiers principes et dégage des vérités physiques et métaphysiques relatives à la nature, à l’homme, aux origines (« tous les hommes ont une conscience », « tous les hommes sont mortels », etc.). Par ailleurs, elle impulse les travaux des sciences particulières (comme ce fut le cas historiquement), s’appuyant ensuite sur leurs résultats pour examiner leur validité métaphysique et tirer d’éventuelles conclusions générales.
Mais le point le plus important sur lequel il faut attirer l’attention est le fait que la métaphysique ou philosophie première est le plus haut degré d’abstraction dans la connaissance intellectuelle plus abstrait que celui des mathématiques et de la physique pure. En effet, qu’est-ce qu’un concept si ce n’est un produit de la raison capable de refléter ou de saisir l’ordre même du réel visible (sciences physiques ou mathématiques) ou invisibles (métaphysique) ? Or, contrairement à l’idée que l’on s’en fait habituellement, un concept n’est pas une figure, un schéma plus ou moins précis ; l’image du concept n’est pas l’origine du concept mais son produit, le résultat d’une activité intellectuelle elle-même immatérielle qui révèle la nature active (force) immatérielle de la raison d’où provient l’aptitude à former des concepts abstraits (le scalpel de l’âme c’est l’âme). Par conséquent, il revient à la science qui étudie cette instance ultime par lesquelles les sciences et leurs critères sont jugés, c’est-à-dire la raison, d’être aussi la science la plus haute dans l’ordre naturel. Dire que la métaphysique est le savoir le plus abstrait, c’est donc aussi dire qu’elle est la science des sciences.
La philosophie n’est pas un savoir encyclopédique ou une systématisation (A. Comte), elle n’est pas davantage cette “sagesse” quelque peu triviale et insipide comme se plaisent à la qualifier certains scientifiques et philosophes (J. Piaget par exemple), faisant quelque peu injure simultanément à la science philosophique et à la vraie sagesse (dans son sens théologique), puisqu’ils assimilent la philosophie à une sorte de vague culture plus ou moins fondée sur des expériences, ou à un ensemble de convictions personnelles ou collectives, au fond assez pauvres, qui seconderait les sciences positives (surestimées).
Combien plus profonde est la pensée d’Aristote affirmant dans Ethique à Nicomaque : « Il est clair par conséquent que la sagesse doit être la plus rigoureuse des sciences », indiquant par là que l’esprit pur est à la source des sciences et de leur véritable rigueur.
Quant à la théologie, science de Dieu, elle « n’a pas d’autorité sur les principes immédiatement évidents d’où procèdent la philosophie » (H. Collin), parce qu’elle œuvre à partir des vérités surnaturelles révélées, mais c’est sans crainte d’arbitraire car la raison garantit par des motifs établis sur une certitude intrinsèque (les vérités métaphysiques et les vérités de raison, vues précédemment ; en particulier l’histoire qui a les caractéristiques des sciences morales) et sur une certitude extrinsèque (la force du témoignage historique, la pérennité et autorité de l’Eglise, les miracles, la mystique).
Après, ce rapide survol des méthodes des sciences, achevons en rappelant que les hypothèses et les lois démontrées peuvent être réunies en un tout plus ou moins systématisé que l’on nomme théorie, c’est-à-dire un ensemble d’hypothèses, de règles logiques et de connaissances vérifiées.
Une des grandes questions de l’épistémologie a été celle de savoir si ces lois ou ces théories peuvent être dites « vraies », la science n’étant jamais achevée quelle que soit sa capacité à acquérir des certitudes
C’est sur cette question du rapport des sciences à la vérité que nous conclurons après avoir donner une réponse à la question initiale.
Conclusion
Nous l’avons dit, pour définir ce qu’est « une science », il faut d’abord caractériser l’essence de « la science », comme activité objective ou comme disposition et vertu de l’esprit.
Qu’est-ce que la science objectivement parlant ? Avec le P. Ch. Lahr nous répondons que la science est « un système de propositions rigoureusement démontrées, constantes, générales, reliées entre elles par des rapports de subordination. ».
Cette définition a l’intérêt de montrer qu’il n’y a science que lorsque sont réunis (ensemble) : une certitude fondée, la recherche et l’établissement des lois causales et une méthode conforme à l’objet étudié.
A présent répondons à la question « qu’est-ce qu’une science ? »
« Une science est un ensemble de connaissances certaines, générales, méthodiques, se rapportant à un objet déterminé. »
Ces définitions et les critères présentés apportent-ils un éclairage sur le problème du rapport des théories scientifiques, de la science, à la notion de vérité ? Que faut-il entendre par vérité ?
On s’accorde à définir la vérité, soit comme la conformité de l’intelligence – qui constate et juge – avec ce qui est (objets des sens ou objets de pensée), soit comme le réel lui-même, jusqu’à qualifier de vérité la source de tout réel.
Or, les trois critères brièvement présentés ici, inséparables de toute activité scientifique, font chacun état de la mise en adéquation de l’esprit avec l’objet de sa recherche, autrement dit expriment la vérité dans son sens logique ou dans son sens ontologique.
La quête de la certitude répond au besoin qu’à l’esprit de connaître de manière assurée. Mais pourquoi une telle recherche si ce n’est pour satisfaire, soit des fins sensibles et utilitaires prochaines, soit pour répondre à un désir plus profond de vérité susceptible de combler tout l’être ? La certitude témoigne de ce que la science est une quête de l’adéquation de la pensée avec ce qui est, ceci en vue de la possession effective d’un bien sensible ou intellectuel.
La recherche des causes réelles vise justement à acquérir les certitudes et les biens que procure la connaissance. La recherche des causes est donc elle-aussi une recherche de ce qui est adéquate au jugement. Cette quête ne saurait s’arrêter aux causes et aux réalités physiques, c’est pourquoi la recherche des causes ne s’entend pas seulement des vérités logiques ou physiques mais également des causes de plus en plus abstraites, premières ou métaphysiques. La notion de cause nous montre à son tour qu’en cherchant des vérités limitées, la science ne peut manquer de remonter aux premiers principes et même aux vérités éternelles et immuables capables de répondre à notre quête de vérité ou d’absolu.
La méthode enfin exprime elle aussi que l’objet d’étude impose son ordre au sujet connaissant exigeant des dispositions et des moyens propres à trouver les causes et les lois qui régissent les choses ou les êtres étudiés. La méthode doit être adéquate à ce qui est étudié, elle provient de la nécessaire adaptation des procédés avec ce qui est, autre expression de la vérité logique et ontologique.
Annexe : Evidence et certitude
Trois ordres de vérités et par suite trois ordres d’évidence et de certitude :
Certitude métaphysique : se caractérise par le caractère inconcevable de sa contradictoire : le tout est plus grand que la partie, 2 × 2 = 4. « Ces vérités sont perçues par la raison, l’évidence et la certitude qu’elles engendrent sont dites métaphysiques »
Certitude physique : a pour caractère d’être contingente, exemple : le soleil brille ; cette propriété pourrait ne pas être attribuée au soleil (par ex. il se peut qu’un jour le soleil s’éteigne). Ce sont des évidences physiques ou empiriques, leur contraire est simplement le faux, à un moment donné.
Certitude morale : relève d’une loi qui caractérise la nature humaine intelligente et libre. Exemple : l’homme tend au bonheur ; l’homme est soumis à la loi du devoir.
*
Evidence immédiate : (physique, métaphysique ou morale) : perçue du premier coup d’œil sans recours à aucune autre évidence intermédiaire : il fait jour, une chose ne peut pas à la fois être et ne pas être.
Evidence médiate : mise en lumière par une autre vérité, par la démonstration : l’ascension des liquides dans le vide est due à la pression atmosphérique, le théorème de Pythagore, ou la victoire de César sur Pompée sont des vérités médiates respectivement physique, métaphysique et morale.
Evidence intrinsèque est perçue directement dans l’objet médiatement ou immédiatement, l’évidence extrinsèque est celle qui est perçue non dans l’objet mais dans l’autorité de celui qui l’affirme, telle est l’évidence des vérités historiques.
Cf. Synthèse à partir de Ch. Lahr, Manuel de philosophie, Beauchesne, 1926, p. 448.
Cet article vous a plu ? MPI est une association à but non lucratif qui offre un service de réinformation gratuit et qui ne subsiste que par la générosité de ses lecteurs. Merci de votre soutien !